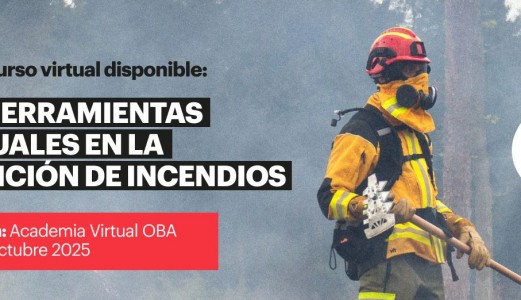L’été 2025 met à l’épreuve la résilience de l’Europe face aux incendies de forêt. De la péninsule Ibérique aux côtes de la mer Égée, d vastes territoires brûlent sous des conditions météorologiques exceptionnelles. Ce n’est pas simplement une saison difficile de plus : c’est un environnement façonné par une chaleur extrême, une sécheresse record et des vents instables, produisant des comportements de feu que de nombreux services d’incendie n’avaient que rarement rencontrés. Pour les équipes en première ligne, cela signifie adapter les tactiques, affiner les priorités opérationnelles et repenser la préparation pour les décennies à venir.
La vague de chaleur qui alimente les incendies
Les météorologues décrivent l’actuelle vague de chaleur comme l’une des plus intenses et prolongées de l’histoire récente de l’Europe.
Elle est due à une dorsale anticyclonique persistante — un « dôme de chaleur » — qui piège l’air chaud sur l’Europe méridionale et centrale. Cela a provoqué :
- Températures diurnes extrêmes : jusqu’à 46 °C au Portugal, 44 °C dans le sud de l’Espagne et plus de 40 °C dans le sud de la France, en Italie et en Grèce.
- Nuits tropicales : des minimales supérieures à 25 °C, empêchant la végétation de regagner de l’humidité.
- Stabilité atmosphérique à grande échelle : qui supprime la formation de nuages et les précipitations pendant plusieurs semaines.
Faible humidité
De vastes zones du sud de l’Espagne, de l’intérieur du Portugal, du sud de l’Italie et des îles Égéennes ont enregistré une humidité relative à un chiffre durant les heures les plus chaudes de la journée — inférieure à 10 % dans des régions comme l’Estrémadure (Espagne), l’Alentejo (Portugal) ou l’Attique (Grèce). Ces niveaux font que les combustibles fins — herbes sèches, brindilles — s’enflamment presque instantanément au contact d’une étincelle ou d’un tison.
Vents persistants
Des vents puissants spécifiques à chaque région aggravent le danger :
- Tramontane (sud de la France et nord-est de l’Espagne)
- Mistral (sud de la France vers la Méditerranée occidentale)
- Etesiens/Meltemi (région égéenne en Grèce et en Turquie)
Ces vents attisent les flammes et peuvent changer brusquement de direction, compliquant les opérations de lutte.

L’Espagne au cœur de la crise
L’Espagne est l’un des pays les plus touchés, avec plusieurs régions confrontées à des incendies de haute intensité.
- Castille-et-León – Las Médulas : Des tourbillons de feu — colonnes de flammes en rotation — ont provoqué une propagation rapide et erratique. Des centaines de personnes évacuées, des maisons détruites et un patrimoine culturel menacé.
- Torrefeta i Florejacs (Lleida) : Un incendie influencé par le passage d’un front orageux a changé brusquement son axe de propagation et a accéléré à des vitesses supérieures à 20 km/h, obligeant à repositionner les tactiques et à mobiliser rapidement des moyens aériens.
- Croissance de végétation après un printemps pluvieux : Après un printemps exceptionnellement humide, l’Espagne a vu pousser une herbe abondante. Aujourd’hui complètement sèche, elle transporte le feu à travers des zones auparavant considérées à faible risque, reliant des secteurs de végétation plus dense et favorisant les incendies de surface à propagation rapide.
Simultanéité des sinistres : Plusieurs feux de grande ampleur ont brûlé simultanément dans différentes régions, certains franchissant les frontières administratives (par exemple Galice–nord du Portugal), ce qui met sous tension la coordination et la répartition des ressources.
Une crise à l’échelle continentale
La situation ne se limite pas à l’Espagne :
- France – Département de l’Aude : Le plus grand incendie depuis des décennies, avec des victimes, des blessés et des milliers d’évacués.
- Portugal – Districts du nord : Plusieurs incendies en interface urbain-forêt, se propageant rapidement à travers pâturages secs et plantations d’eucalyptus.
- Grèce – Rhodes, Attique et Eubée : Des milliers d’évacués dans les zones côtières et touristiques.
- Turquie – Côte égéenne : Un important incendie a coûté la vie à 10 pompiers, rappelant le lourd tribut humain de ces épisodes extrêmes.
- Italie – Sicile et Sardaigne : Fermeture d’aéroports, dégâts aux infrastructures et milliers d’hectares détruits.
- Royaume-Uni – Angleterre et Écosse : Incendies de prairies et de landes qui mettent à l’épreuve des brigades principalement formées à la lutte contre les feux de structures.
Tout cela pendant l’été 2025, dessinant un défi synchronisé à l’échelle européenne.
Comment le changement climatique transforme le comportement du feu
Tous les incendies de cet été n’ont pas été de sixième génération, mais plusieurs tendances clés sont évidentes :
- Propagation plus rapide sous des conditions météorologiques extrêmes.
- Une population plus nombreuse vivant dans l’interface urbain-forêt, ce qui accroît les risques d’ignition et complique les opérations.
- De nombreux services encore peu préparés sur le plan opérationnel : disposant de véhicules et d’aéronefs, mais sans outils pour définir les priorités ou établir des stratégies optimales.
Cette combinaison — feux rapides, forte exposition et stratégie incohérente — rend la lutte plus difficile et amplifie les pertes.
L’extinction à l’ère nouvelle
Cette nouvelle ère ne remplace pas les outils traditionnels ; elle les améliore grâce à des capacités avancées. Les outils manuels, les lignes de tuyaux et les coupe-feu restent essentiels, mais doivent être complétés par :
- Une meilleure disponibilité de l’eau dans les zones reculées : réservoirs portables, points de ravitaillement pour aéronefs et systèmes de pompage longue distance.
- Unités de pompage à déploiement rapide capables de fournir débit et pression sur terrain escarpé.
- Renseignements en temps réel via drones et satellites pour anticiper la propagation et ajuster les tactiques en conséquence.
Ces mesures accroissent l’autonomie dans les zones isolées, réduisent les délais d’intervention et élargissent les marges de sécurité.
Conclusion
Les incendies de 2025 ne sont pas une anomalie : ils prolongent un schéma observé en 2021 et 2022. Chaque année, les combustibles s’accumulent, la sécheresse s’aggrave et les épisodes météorologiques extrêmes s’étendent sur des territoires plus vastes. Résultat : des feux plus fréquents, plus graves et plus étendus.
Ce n’est plus un avertissement : c’est notre réalité opérationnelle. Y répondre efficacement exige une évolution tactique constante, une formation ciblée et des investissements dans des équipements conçus pour les conditions auxquelles les pompiers sont confrontés aujourd’hui — et auxquelles ils devront faire face de plus en plus souvent.